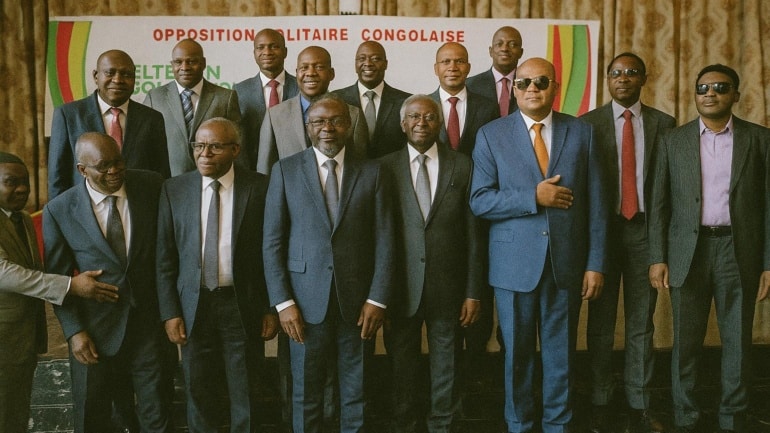Une missive haineuse qui transcende les frontières
Le 11 juillet dernier, les couloirs feutrés du Palais-Bourbon ont été le théâtre silencieux d’une violence symbolique retentissante : une lettre anonyme, truffée d’insultes racistes et sexistes, adressée à Nadège Abomangoli, troisième vice-présidente de l’Assemblée nationale française et native de Brazzaville. L’élue, qui représente la Seine-Saint-Denis sous les couleurs de La France insoumise, a immédiatement saisi le parquet de Paris. L’acte judiciaire, loin d’être un simple réflexe procédural, constitue un geste politique destiné à rappeler que l’égalité républicaine n’est pas négociable même dans la patrie qui l’a érigée en devise.
Portée symbolique pour les femmes congolaises
Dans l’imaginaire collectif des Congolaises, la trajectoire d’Abomangoli est souvent citée comme une preuve tangible que les plafonds de verre peuvent se fissurer. Voir l’une des leurs accéder aux plus hautes sphères d’un État européen installe un horizon d’attente inédit. La violence verbale qu’elle subit montre toutefois que la reconnaissance institutionnelle ne garantit pas la sécurité symbolique. « Ce qu’elle vit en France résonne chez nous ; les stéréotypes se déplacent mais ne disparaissent pas », confie Gisèle Mbemba, sociologue à l’Université Marien-Ngouabi.
Racisme et sexisme en politique hexagonale
La politologue française Sarah Mazari rappelle que « la féminisation et la diversification de l’hémicycle génèrent un backlash prévisible ». Les attaques contre Abomangoli s’inscrivent dans une série d’incidents visant des parlementaires afro-descendants, dont Carlos Martens Bilongo ou Aly Diouara. Le passage à l’acte épistolaire, anonyme mais structuré, relève d’un mépris racialisé qui entend délégitimer la présence des minorités dans le processus décisionnel. Cette rhétorique identitaire recycle l’idée, vieille de plus d’un siècle, d’une incompatibilité supposée entre appartenance africaine et exercice du pouvoir dans l’espace public occidental.
Cadre juridique : de la plainte au procès
Le choix retenu par l’avocate Chirinne Ardakani – outrage envers une personne dépositaire de l’autorité publique et injure à caractère raciste et sexiste – illustre la sophistication du droit français en matière de lutte contre les discours de haine. Depuis la loi de 1881, constamment enrichie, la jurisprudence admet que la qualité de « femme noire » appartient aux catégories protégées. Si le parquet suit les réquisitions, l’auteur encourt jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Au-delà du volet pénal, la procédure ouvre la voie à d’éventuelles réparations civiles, dont le montant, certes symbolique, servirait à financer des actions de prévention.
Miroir congolais des mécanismes de protection
Le Congo-Brazzaville, signataire de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, propose depuis 2019 une ligne verte pour signaler les violences basées sur le genre. Même si le contexte institutionnel diffère, la mobilisation rapide d’Abomangoli rappelle l’importance de dispositifs accessibles. Dans les deux capitales, la sanction judiciaire ne saurait suffire ; elle doit s’accompagner d’un travail pédagogique pour déconstruire les stéréotypes. Les programmes menés par le ministère congolais de la Promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement, appuyés par plusieurs ONG, témoignent d’une volonté politique de renforcer la résilience des victimes sans opposer les sexes ni les appartenances nationales.
Voix d’expertes et écho générationnel
Pour Amandine Ngoma, psychologue sociale, « l’injure raciste vise l’altérité visible ; l’injure sexiste, l’altérité statutaire ». Leur combinaison produit une violence cumulative, souvent sous-estimée. Les jeunes étudiantes de l’Institut supérieur des sciences et techniques de Brazzaville, interrogées lors d’un atelier, y voient la preuve que l’accès aux fonctions dirigeantes reste un combat de longue haleine des deux côtés de l’Atlantique. L’affaire Abomangoli devient ainsi un récit d’avertissement mais aussi de détermination : céder serait admettre la validité du message.
Entre résistance individuelle et responsabilité collective
En décidant de « ne pas se laisser intimider », la vice-présidente française actualise une posture de résilience que beaucoup de Congolaises adoptent face aux micro-agressions quotidiennes, rurales ou urbaines. La vigilance citoyenne – qu’elle émane d’un parquet parisien ou des comités locaux de veille au Congo – demeure la clef d’une société qui refuse la hiérarchie des humanités. L’issue judiciaire de cette affaire, attendue avec attention, pèsera moins que sa capacité à nourrir un débat public mature sur la place des femmes, de surcroît noires, dans la décision politique.