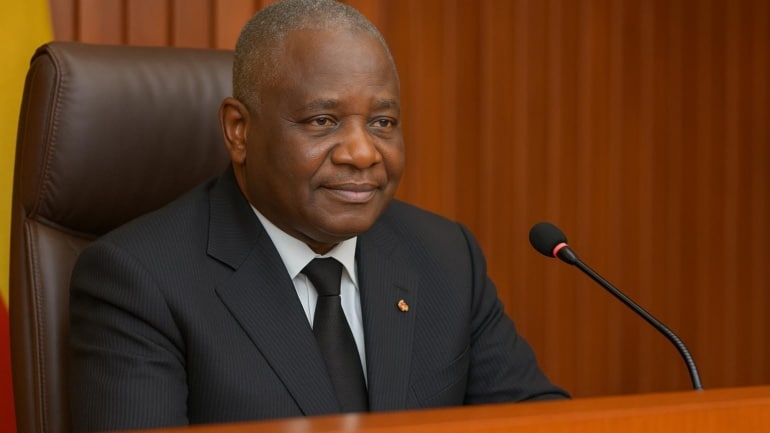Un panorama socio-juridique en mutation
Au lendemain de la Conférence nationale souveraine de 1991, la question du genre s’est progressivement invitée dans l’agenda politique congolais. L’adoption du Code de la famille révisé en 2019, puis de la Loi n° 30-2022 portant prévention et répression des violences faites aux femmes, constitue une inflexion notable. Ces textes, salués par les organisations internationales, alignent désormais le dispositif national sur les engagements pris auprès de la CEDAW et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine. « Nous disposons d’une architecture juridique robuste ; l’enjeu est à présent son application effective dans chaque localité », observe la sociologue Élise Ngoma, chargée d’études au Centre de recherche en sciences sociales de l’Université Marien-Ngouabi.
Des données encore fragmentaires sur les violences
Le dernier Module genre de l’Enquête démographique et de santé (EDS 2021) estime que 36 % des Congolaises âgées de 15 à 49 ans ont déjà subi une violence physique ou sexuelle. Si ces chiffres placent le pays sous la moyenne régionale, les sociologues alertent sur les zones d’ombre : la sous-déclaration demeure élevée en milieu rural, et les violences économiques, moins visibles, échappent souvent au radar statistique. La Direction générale de la famille envisage de coupler la prochaine EDS à un dispositif qualitatif afin de mieux cerner les formes émergentes de cyber-harcèlement touchant les adolescentes urbaines.
Initiatives institutionnelles et partenariales
La stratégie nationale de promotion de la femme 2023-2027, pilotée par le ministère en charge du genre, prévoit la création de centres d’écoute supplémentaires dans les départements de la Cuvette et du Niari. Financé conjointement par la Banque africaine de développement et l’État congolais, le dispositif vise un maillage territorial plus équitable. « Nous voulons que chaque survivante puisse trouver un interlocuteur à moins de 50 kilomètres », précise la directrice de cabinet, Antoinette Mampouya. Sur le terrain, la collaboration avec les autorités locales se consolide : les comités de vigilance communautaires, appuyés par le PNUD, multiplient les campagnes de sensibilisation dans les langues vernaculaires, réduisant ainsi les résistances culturelles.
Voix de la société civile féminine
Le tissu associatif congolais s’est épaissi depuis les années 2000, porté par des ONG telles que Azur Développement ou la Plateforme des femmes pour la paix. Leur rôle allait bien au-delà de la dénonciation ; elles assurent la médiation avec les chefs coutumiers, forment les magistrats de première instance et documentent les cas de violence à des fins de plaidoyer. « Notre relation avec les pouvoirs publics s’est professionnalisée, nous sommes désormais consultées lors de la rédaction des rapports périodiques à New York », se félicite Jeannette Okemba, présidente de l’Observatoire congolais des violences faites aux femmes. Cette synergie contribue à une meilleure appropriation des normes internationales par l’administration nationale.
Perspectives de recherche et de mobilisation
La numérisation des procédures judiciaires, annoncée pour 2025, devrait faciliter le suivi des plaintes relatives aux violences basées sur le genre et réduire la lenteur des dossiers. Parallèlement, les universités congolaises intègrent progressivement des modules de sociologie du genre, nourrissant un vivier de chercheurs capables de produire des données endogènes. À l’horizon 2030, les analystes tablent sur un triplement du nombre de femmes diplômées en criminologie, indispensable à l’essor d’une expertise locale.
Si les défis restent patents – prise en charge psychosociale encore embryonnaire en zone forestière, obstacles économiques pour les jeunes entrepreneuses, persistance des stéréotypes –, la dynamique enclenchée témoigne d’une volonté collective de faire bouger les lignes. Les indicateurs macro-économiques favorables offrent une fenêtre d’opportunité pour des investissements publics plus soutenus dans les services sociaux de base, levier incontournable pour l’autonomisation des femmes congolaises.