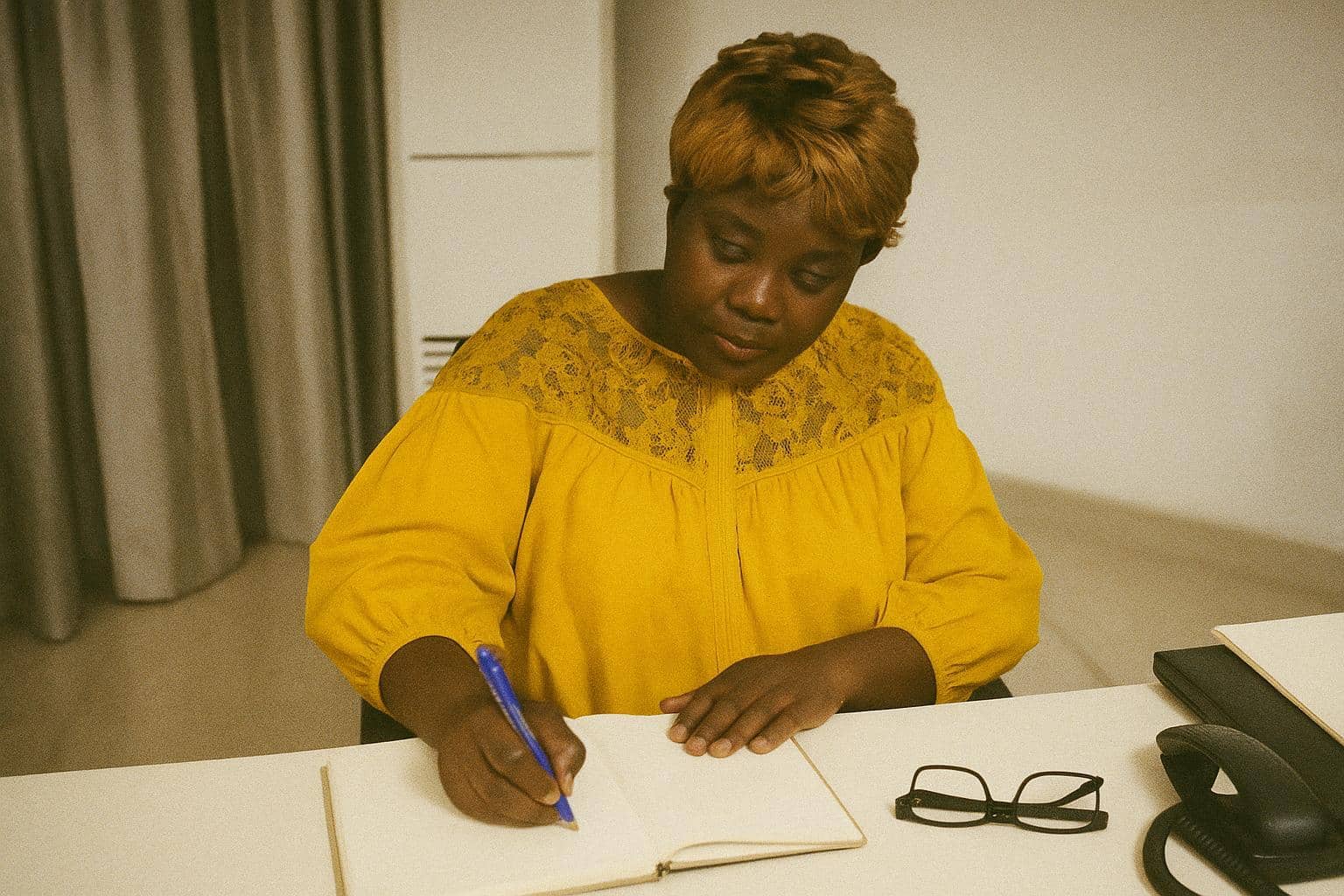Une légalité contestée par les organisations citoyennes
La publication, le 27 juin 2025 à Brazzaville, d’une note de position de l’Observatoire congolais des droits de l’homme (OCDH) a ravivé le débat sur les autorisations provisoires d’exploitation forestière. Cinq entreprises – SPIEX, Congo Dejia Wood Industry, SEFYD, SIFCO et SICOFOR – continuent de prélever du bois malgré l’expiration, entre 2022 et 2024, de leurs conventions d’aménagement et de transformation. Aux yeux de la société civile, ces permis de transition octroyés par le ministère de l’Économie forestière contreviennent aux articles 175 et 192 du Code forestier qui imposent un réexamen préalable des engagements environnementaux et sociaux.
Les ONG, tout en saluant les efforts constants des pouvoirs publics pour moderniser la filière bois, estiment que le maintien de ces titres provisoires crée une zone grise juridique. « Sans nouveaux cahiers des charges, la conformité demeure théorique », explique Nina Cynthia Kiyindou Yombo, directrice exécutive de l’OCDH, pointant le risque d’exportations classées illégales par les partenaires internationaux.
Conséquences socio-économiques pour les femmes rurales
Derrière le débat technique se profilent des répercussions concrètes pour les communautés villageoises, particulièrement pour les femmes qui dépendent des produits forestiers non ligneux pour leur subsistance. Dans le district de Tsiaki, plusieurs épouses de planteurs affirment avoir vu les sites de collecte de feuilles comestibles se réduire, forçant un allongement des trajets quotidiens. Selon une enquête de terrain réalisée par l’Observatoire congolais des violences faites aux femmes, la raréfaction des ressources accroît la charge domestique et limite l’accès au marché local, compromettant l’autonomisation économique féminine.
La question de la redistribution des redevances forestières, déjà prévue par la loi, se pose avec acuité. Lorsque les conventions arrivent à terme sans être évaluées, les fonds destinés aux projets communautaires – puits, dispensaires, écoles – tardent à être débloqués. Or, ces infrastructures représentent souvent un filet de sécurité sanitaire et éducatif pour les mères de famille.
Engagements étatiques et cadre normatif renforcé
Le gouvernement congolais, signataire de l’Accord de partenariat volontaire FLEGT avec l’Union européenne, réaffirme sa détermination à asseoir une gestion durable des forêts conforme aux standards internationaux. Depuis 2023, plusieurs arrêtés ministériels introduisent des dispositifs de traçabilité numérique du bois, tandis qu’une commission interministérielle planche sur la révision des cahiers des charges pour intégrer des indicateurs de genre.
Le ministère de la Promotion de la femme et de l’Intégration de la femme au développement rappelle que l’article 14 de la Constitution consacre l’égalité d’accès aux ressources naturelles. Dans cette optique, des formations à l’entrepreneuriat vert ont été lancées à Impfondo et Sibiti afin de diversifier les revenus des foyers et réduire la dépendance au seul abattage.
Dialogue constructif entre État, industrie et société civile
Face aux préoccupations, le Conseil consultatif des forêts a convié début juillet un panel réunissant représentants ministériels, opérateurs économiques et ONG. Les échanges ont permis d’esquisser un calendrier d’évaluation des concessions expirées et d’envisager la suspension progressive des titres provisoires dès que les audits écologiques et sociaux auront été publiés.
De l’avis d’Anne-Claire Mabiala, professeure à la faculté de droit de l’Université Marien-Ngouabi, « l’annulation sans concertation risquerait de précariser des centaines d’emplois locaux ». Elle prône une solution hybride : reconduire temporairement les permis sous strict contrôle, conditionner toute extraction à la mise en œuvre immédiate des obligations sociales, notamment la construction d’infrastructures promises.
Perspectives pour une gouvernance inclusive et durable
Les ONG insistent sur la nécessité d’intégrer les cheffes de groupements féminins dans les comités de suivi des concessions afin d’objectiver les indicateurs de bien-être communautaire. Cette approche rejoint la Stratégie nationale genre et climat qui mise sur la participation des femmes comme vecteur de transparence.
À moyen terme, la mise en place d’un fonds d’investissement local, alimenté par une fraction des redevances forestières, pourrait financer des initiatives portées par des associations féminines : pépinières agro-forestières, unités de transformation de fruits sauvages, programmes d’alphabétisation financière. Autant de pistes qui contribueraient à concilier exploitation économique, préservation des écosystèmes et promotion des droits des Congolaises.