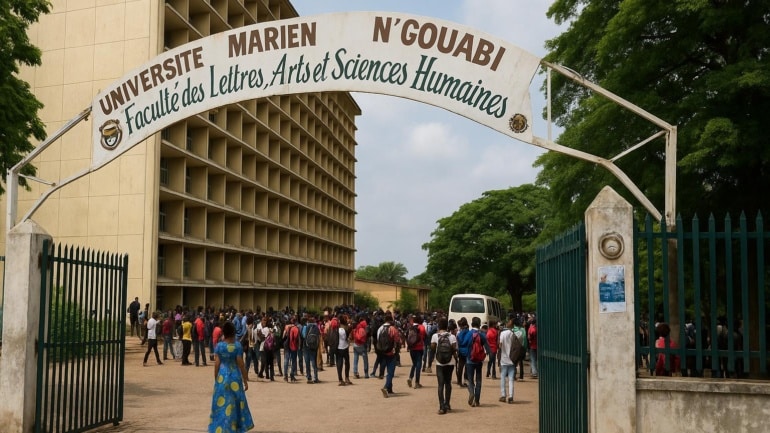Le marché, miroir de la cité
À l’entrée du marché Total de Bacongo, les passants croisent depuis plusieurs semaines une échoppe tapissée d’images de femmes nues et de scènes suggestives. Dans ce cœur commercial animé, ce contraste saisissant soulève des interrogations sur les limites acceptables de la visibilité du corps.
Pour de nombreuses mères venues acheter légumes ou savon, l’exposition leur semble intrusive, surtout lorsqu’elles sont accompagnées de jeunes enfants. « Je dois détourner son regard chaque fois », confie Mireille, enseignante de 34 ans, venue du quartier Moukondo. Son témoignage illustre un malaise collectif latent dans ce marché populaire.
Le vendeur, lui, assure proposer des solutions « naturelles » pour la vitalité sexuelle et la prise de formes, argument commercial fréquent dans les grandes capitales africaines. Il revendique un droit à la libre entreprise, convaincu que ses images prouvent l’efficacité des produits et facilitent la vente auprès des clients.
Une vitrine qui heurte la pudeur
D’après la sociologue Clarisse Malanda, la rue congolaise demeure un espace partagé qui devrait préserver une symbolique d’intimité. « L’hypersexualisation visible déstabilise les rapports sociaux, surtout dans un pays où la solidarité communautaire prime », explique-t-elle, rappelant que la pudeur publique relève d’une négociation culturelle permanente entre générations et genres.
Les clientes interrogées dénoncent aussi un double standard. Pendant que les vendeuses installées au sol sont dispersées pour trouble à l’ordre, l’affichage d’images sexuelles, lui, reste toléré. Cette perception nourrit un sentiment d’injustice symbolique, susceptible d’éroder la confiance dans la régulation des espaces marchands aux yeux des femmes.
Les organisations de la société civile rappellent cependant que la répression n’est pas une fin en soi. L’affichage non régulé témoigne aussi d’un déficit d’information sur les normes légales, déficit qu’elles proposent de combler par des séances de sensibilisation conjointes avec les autorités locales et les vendeurs concernés.
Cadre légal congolais sur la décence publique
La loi congolaise sur la protection des mineurs interdit la diffusion de contenus à caractère pornographique dans les lieux accessibles à tous. Selon Me Stéphane Obami, avocat au barreau de Brazzaville, l’article 234 du code pénal expose les contrevenants à des amendes et peines d’emprisonnement en cas répété.
Le ministère du Commerce a également publié en 2020 une note circulaire exigeant que les emballages de produits importés respectent la moralité publique. Les opérateurs doivent, à défaut, masquer les illustrations jugées offensantes. Cette directive reste souvent méconnue des petits détaillants présents dans les marchés municipaux de district.
La police administrative, chargée d’appliquer ces textes, opère sous la tutelle de la mairie d’arrondissement. Un officier requérant l’anonymat affirme que ses équipes « manquent de formation spécifique et parfois de matériel pour notifier les infractions ». Il plaide pour un renforcement des outils d’inspection et des procédures de suivi.
Impact psychosocial sur femmes et enfants
Les psychologues du centre Lemba soulignent que l’exposition précoce à la pornographie perturbe la construction des repères affectifs. L’enfant associe sexualité et marchandisation, précise la clinicienne Prisca Ndzalé. Chez les jeunes filles, cela peut renforcer l’idée que la valeur féminine passe d’abord par la plastique du corps exhibé.
Pour les femmes adultes, l’omniprésence d’images normatives de corps accentue la pression esthétique. Aminata Mbala, couturière, explique ressentir l’injonction à « gonfler » ses formes pour rester désirable. Cette pression tient davantage de l’économie informelle des cosmétiques que d’un choix éclairé, analyse la chercheuse Malanda dans son dernier article académique.
À long terme, préviennent les spécialistes, cette normalisation de la pornographie au coin de la rue risque d’ériger l’accès au corps des femmes en bien de consommation immédiat, avec des répercussions sur la dynamique des violences basées sur le genre qui demeurent déjà préoccupantes dans le pays entier.
Responsabilités partagées et pistes d’action
Le Conseil municipal de Bacongo prépare actuellement un projet d’arrêté redéfinissant l’affichage autorisé dans les zones marchandes. L’élu Rosalie Mabika assure qu’une consultation publique sera lancée prochainement pour équilibrer liberté commerciale et protection des mineurs, tout en évitant un climat de confrontation stérile entre acteurs du marché local.
Du côté des associations, l’Observatoire national congolais des violences faites aux femmes projette une campagne intitulée « Mon marché, mon image ». Elle conjuguera affiches éducatives, dialogues avec vendeurs et ateliers parents-enfants afin de promouvoir une culture du consentement visuel dans les espaces publics des deux rives du fleuve Congo.
Les spécialistes suggèrent enfin de renforcer les programmes scolaires d’éducation à la sexualité, en y intégrant un volet sur l’esprit critique face aux supports médiatiques. Une telle approche, soutenue par l’UNESCO, a montré ailleurs qu’elle réduit l’influence des contenus stéréotypés et encourage des relations respectueuses dès le collège.
En attendant ces réformes, de simples gestes peuvent faire une différence: orienter l’échoppe vers la confidence plutôt que l’étalage cru, couvrir les emballages litigieux, offrir aux clients une brochure explicative. Dans un marché vivant, chaque acteur contribue à façonner le paysage visuel partagé et la sécurité des regards.