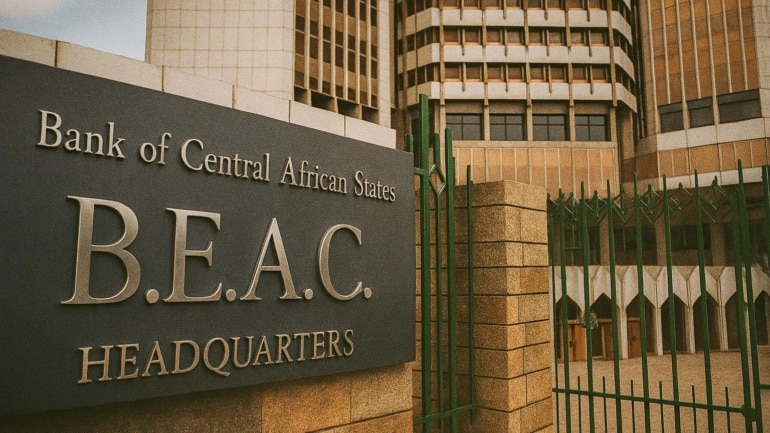Un taux national historique de 68,10 %
À la veille des célébrations du 15 août, les lampions se sont allumés sur les résultats du Brevet d’Études du Premier Cycle 2025: 68,10 % de réussite nationale, un jalon perçu comme prometteur par l’ensemble des acteurs de l’éducation congolaise.
Le ministre Jean Luc Mouthou, soulignant « la persévérance des élèves et la résilience du corps enseignant », a salué ce cap tout en rappelant que l’ambition demeure l’excellence académique, porte d’entrée vers une croissance inclusive et durable.
Sur 123 515 candidats, 84 111 ont validé l’examen, une performance qui consolide la courbe ascendante amorcée depuis trois sessions et reflète le travail de fond mené dans les établissements urbains comme ruraux.
La dynamique des départements performants
Au nord, la Sangha s’illustre avec 78,09 % de succès, suivie des Plateaux à 77,40 % et de la Cuvette à 75,81 %; ces résultats témoignent d’un maillage pédagogique resserré et d’une mobilisation communautaire souvent citée en exemple par les inspecteurs.
Les départements côtiers, Kouilou et Pointe-Noire, dépassent 65 %, tandis que Brazzaville maintient son rang avec 69,26 %, suscitant un optimisme prudent dans une capitale confrontée à une démographie scolaire dense et à des défis logistiques récurrents.
Des avancées tangibles pour les filles
Si les chiffres grossissent les performances, c’est toutefois la qualité des apprentissages qu’interroge désormais l’Observatoire national congolais des violences faites aux femmes : la réussite doit se doubler d’un contenu émancipateur, propice à l’autonomie des filles comme des garçons.
Selon les premières données ventilées par genre, 49,8 % des admis sont des candidates, un ratio qui frôle la parité et confirme l’efficacité des campagnes de sensibilisation au maintien des filles à l’école primaire et au collège.
Dans certains centres de la Sangha, le taux d’admission des filles culmine même à 82 %, signe d’un encadrement rapproché et d’initiatives locales, comme les clubs de lecture féminins, qui réduisent les abandons précoces.
Interrogée, Mme Clarisse Ongagna, inspectrice départementale, rappelle que « chaque point gagné se construit dès la maternelle, par l’accès simultané des filles et des garçons aux manuels, aux laboratoires et aux activités sportives ».
Politiques publiques et investissements stratégiques
Cet accent porté sur l’égalité trouve un écho dans la Stratégie nationale genre 2022-2026, qui prévoit des bourses ciblées, des toilettes séparées et des dispositifs de signalement des violences en milieu scolaire, facteurs identifiés comme leviers majeurs de rétention.
Sur le plan budgétaire, le gouvernement a porté en cinq ans la part de l’éducation à près de 17 % des dépenses publiques, un ratio supérieur à la moyenne d’Afrique centrale, facilitant la réhabilitation de 420 salles de classe et la dotation en tablettes pédagogiques.
Des partenariats avec des entreprises locales de télé-communication ont par ailleurs permis d’équiper des collèges ruraux en connexion internet, ouvrant des plateformes d’apprentissage à distance qui ont montré leur pertinence durant les interruptions liées à la pandémie.
Défis persistants et réponses envisagées
Malgré ces avancées, l’observation de terrain souligne la disparité persistante entre établissements publics et privés, notamment en matière de taille des classes ou d’accès aux laboratoires de sciences, variables qui influencent la confiance des élèves lors des évaluations certificatives.
Le ministre Mouthou affirme vouloir « poursuivre la déconcentration des inspections » afin d’offrir un accompagnement pédagogique plus fréquent dans les zones enclavées, où la rotation des formateurs reste un défi logistique et financier.
À Brazzaville, plusieurs associations de parents plaident pour l’introduction de séances de remédiation gratuites après les heures de classe, estimant que les cours particuliers exacerbent les inégalités et limitent l’accès des familles modestes à un soutien scolaire de qualité.
Symbolique nationale et impact sociétal
Les résultats publiés avant la fête nationale jouent aussi un rôle symbolique : ils participent au récit d’une indépendance tournée vers le savoir, et rappellent que l’édification d’une nation passe par une jeunesse instruite, critique et créative.
Le professeur de sociologie Sylvain Ibara souligne toutefois que « le diplôme n’est qu’une étape ; l’enjeu réside dans la capacité du système à transformer la certification en capital social et économique, notamment pour les jeunes filles issues de milieux défavorisés ».
En 2026, un suivi longitudinal des admis sera lancé afin de mesurer l’impact du BEPC sur les poursuites d’études et l’insertion, démarche qui devrait éclairer de nouvelles politiques destinées à consolider les acquis et à réduire les abandons en classe de seconde.
Vers une excellence inclusive et numérique
Le déploiement d’une plateforme nationale d’évaluation continue, annoncé pour la rentrée 2025-2026, vise à fournir aux enseignants des indicateurs en temps réel et à alerter précocement sur les difficultés d’apprentissage, réduisant ainsi les risques de décrochage, notamment chez les adolescentes vivant en internat.
Dans son allocution, le Premier ministre Anatole Collinet Makosso a rappelé que la réussite du BEPC ne saurait être l’apanage des lauréats seuls : « Elle appartient à la Nation entière, aux familles, aux enseignants, aux collectivités ». Cet appel à l’excellence collective cristallise la direction à suivre pour un Congo compétitif et équitable.
Le rendez-vous est pris : septembre prochain révélera les premiers effets des réformes audacieuses engagées.