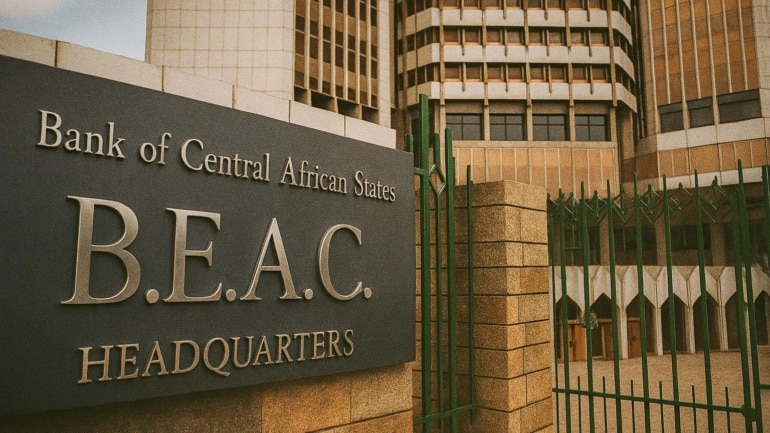Pénurie de bois : un paradoxe national
À Brazzaville, la scie des artisans résonne moins fort. Depuis plusieurs mois, l’accès au bois d’œuvre se complique, faisant monter les coûts et ralentissant les commandes. Dans cet écosystème en tension, les femmes, encore minoritaires mais déterminées, portent une voix singulière et méritent l’attention.
Le Salon des métiers du bois, ouvert le 11 août, a mis en lumière ces difficultés. Patrick Hubert Monampassi, dirigeant de « Meubles Monampassi », a insisté sur la rareté du bois issu directement des scieries. Les professionnels s’approvisionnent surtout en quincailleries, au prix d’une marge étouffante.
Pour les artisanes, la contrainte logistique s’ajoute. Gisèle Milandou raconte devoir parcourir des dizaines de kilomètres jusqu’à son village d’origine, charger du bois de fer, puis payer le transport jusqu’à la capitale. Chaque aller-retour érode sa rentabilité et limite ses perspectives de croissance.
Ces récits illustrent une tension paradoxale : le Congo reste l’un des premiers producteurs africains de grumes, mais l’artisanat local souffre d’un accès restreint aux sciages. Les chaînes d’exportation absorbent la majorité du flux, laissant peu de volume à la transformation domestique.
Conséquences sur les femmes artisanes
Le ministère de l’Économie forestière rappelle pourtant que la loi réserve un quota de matière première au marché national. « L’enjeu est d’acheminer le bois vers des points de distribution accessibles aux petites unités », souligne un cadre technique, évoquant la création prochaine de dépôts urbains stratégiques.
Une telle initiative répondrait à une problématique genrée. Selon l’Observatoire national congolais des violences faites aux femmes, près d’une artisane sur deux manque d’outils motorisés, faute de trésorerie. La disponibilité d’un bois moins cher réduirait la dépendance à des intermédiaires souvent décourageants pour les entrepreneures.
Le Programme national de développement prévoit, dans son pilier industriel, le renforcement des clusters artisanaux. Un accord-cadre signé en juillet avec le Bureau international du travail prévoit des ateliers de formation sur l’optimisation des chutes de bois, limitant ainsi le gaspillage et maximisant la valeur ajoutée locale.
Pour les organisations féminines, il est essentiel d’associer la distribution de matières premières à un accompagnement financier. « Nous plaidons pour un fonds de roulement dédié aux femmes du secteur boiserie », explique Nadège Badinga, sociologue, convaincue que l’autonomie économique reste un bouclier contre la violence domestique.
Dans les ateliers de Makélékélé, l’absence de tronçonneuses adaptées oblige souvent à sous-traiter la première découpe. Le coût moyen d’un plateau grimpe alors de 30 %. Cette charge réapparaît ensuite dans le prix final des meubles, freinant une clientèle locale déjà fragilisée par le pouvoir d’achat.
Réponses institutionnelles en cours
D’un point de vue macroéconomique, l’accès limité au bois entrave la diversification voulue par les autorités. Le secteur artisanal représente pourtant une source d’emplois non délocalisables. Selon la Chambre de métiers, chaque scierie de proximité pourrait générer cinq emplois directs et stimuler un réseau informel dynamique.
La Direction générale des industries locales étudie un mécanisme de bonification fiscale pour les usines acceptant de réserver une partie de leur production aux micro-entreprises. Le projet, encore au stade de consultation, inclut une clause d’accès préférentiel pour les structures tenues ou majoritairement employant des femmes.
Au-delà de la matière, l’accès à l’information reste crucial. Plusieurs artisanes affirment découvrir des programmes de soutien une fois les dossiers clos. La mise en ligne d’un portail unique, annoncée par l’Agence de développement de l’artisanat, devrait centraliser appels d’offres, fiches techniques et formulaires simplifiés.
Innovation et partenariats privés
Les établissements de formation professionnelle, tels que l’Institut national Kamanga, renforcent leurs modules de gestion environnementale. L’idée est de sensibiliser dès l’apprentissage à l’exploitation raisonnée des forêts communautaires. Un usage responsable sécurise la ressource et ouvre la porte à des labels pouvant accroître la valeur des produits.
Parallèlement, des start-up locales développent des applications reliant scieries et acheteurs. L’interface Mobili-Bois permet déjà de consulter les stocks en temps réel, réduisant les déplacements inutiles et offrant aux artisanes une négociation plus transparente des volumes désirés.
Certaines entreprises forestières, conscientes de leur rôle sociétal, expérimentent la vente directe aux artisans via des points éphémères. La coopérative Selva Congo a ainsi écoulé vingt-cinq mètres cubes de limba à Bacongo, à un tarif inférieur de 18 % par rapport au circuit traditionnel.
Ces avancées restent toutefois ponctuelles. Pour pérenniser le modèle, les associations professionnelles proposent un observatoire des prix du bois, comparable à celui du carburant. La transparence faciliterait la planification et découragerait la spéculation, garantissant aux consommatrices une meilleure lisibilité des tarifs des meubles.
Vers un écosystème durable et inclusif
À moyen terme, la combinaison d’incitations fiscales, de plateformes logistiques urbaines et de formation spécialisée pourrait créer un écosystème renouvelé. Les artisanes y gagneraient en compétitivité, les ménages en qualité, et l’économie nationale en diversification, dans le respect des orientations fixées par le gouvernement.
Le bruit des rabots, encore étouffé par la pénurie, pourrait alors retrouver son écho dans chaque quartier. Soutenir l’accès au bois, c’est encourager une filière créatrice d’emplois féminins, porteuse d’identité culturelle et vectrice de cohésion sociale pour toute la communauté congolaise.