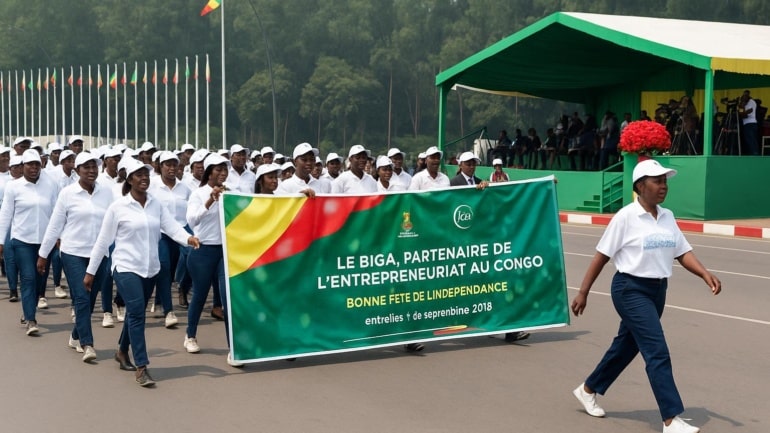Une moisson d’excellence inattendue
Le rideau s’est levé le 13 juillet dans l’amphithéâtre du Lycée technique industriel 1er Mai, dévoilant un chiffre presque irréel : 99,23 % de réussite pour la Bouenza. Sur les 15 843 candidats nationaux, 7 681 ont obtenu le précieux sésame, soit un taux global de 48,48 %, en hausse de plus de cinq points par rapport à 2024. Si les félicitations officielles ont fusé, la stupeur a dominé les couloirs des rectorats ; jamais depuis la création du bac technique, un département n’avait frôlé la perfection statistique. Le Dr Armel Ibala Nzamba, président des jurys, qualifie cette performance de « sursaut collectif témoignant d’une appropriation effective du référentiel de compétences ».
Sur le terrain, enseignants et chefs d’établissement soulignent la préparation méthodique menée tout au long de l’année, souvent en partenariats public-privé. « Nos ateliers métallurgiques sont restés ouverts le samedi, grâce à l’appui ponctuel de l’industrie locale », confie un proviseur de Madingou. Le résultat illustre aussi l’effet d’entraînement : face à des réussites historiques au bac général dans le même département l’an passé, les filières techniques ont redoublé d’efforts, cherchant à montrer qu’elles peuvent, elles aussi, incarner l’excellence nationale.
Les réformes, arbitre discret de la session 2025
Le cru 2025 est marqué par l’application intégrale d’un principe simple : une seule candidature possible, soit au bac général, soit au bac technique. La mesure, annoncée conjointement par les ministres Ghislain Thierry Maguessa Ebomé et Jean-Luc Mouthou, a coupé court aux doubles inscriptions qui, selon la tutelle, nourrissaient fraudes et statistiques en trompe-l’œil. L’interdiction a mécaniquement réduit le nombre de postulants, mais a consolidé la motivation des restants, plus concentrés sur leur filière de prédilection.
Cette rationalisation s’accompagne d’une refonte des grilles d’évaluation, davantage centrées sur la résolution de problèmes concrets et la soutenabilité environnementale des projets techniques. La barre d’admission maintenue à 10/20 paraît classique, mais la pondération des coefficients valorise désormais l’expérimentation en atelier. D’après le Service de planification du ministère, la réforme a surtout rehaussé la lisibilité du diplôme auprès des entreprises nationales, désireuses de recruter des techniciens immédiatement opérationnels.
La variable genre, indicateur de progrès social
L’Observatoire congolais des violences faites aux femmes note une évolution encourageante : 46 % des admis sont des jeunes filles, contre 39 % en 2024. Dans les spécialités Électrotechnique et Maintenance industrielle, la proportion féminine atteint même 31 %, seuil inédit dans un cursus historiquement masculin. Pour Philomène Ngoma, sociologue de l’éducation, « le bac technique devient un sas d’autonomisation économique pour les femmes, surtout dans les zones rurales où les débouchés demeurent rares ».
Les autorités n’ont pas manqué de rappeler l’objectif fixé par la Stratégie nationale genre : parvenir à la parité dans l’enseignement technique à l’horizon 2030. Les bourses incitatives et la création de dortoirs sécurisés pour les filles à Dolisie ou Nkayi semblent porter leurs fruits. Interrogée pendant la proclamation, Monique Mfouta, major de promotion en Chaudronnerie, confiait sa fierté : « J’ai grandi en voyant mon père réparer des moteurs ; aujourd’hui, je peux théoriser ce geste et le transformer en carrière ». Cet imaginaire renouvelé pourrait, à terme, réduire les discriminations salariales encore observées à l’embauche.
Disparités territoriales : entre défi et synergie
À l’autre bout du spectre, la Cuvette-Ouest enregistre un modeste 19,83 % de réussite, rappelant la persistance des fractures territoriales. Contraintes logistiques, manque d’équipements et rotation rapide du personnel enseignant figurent parmi les explications avancées par les autorités départementales. Néanmoins, un programme de jumelage vient d’être conclu : des lycées techniques de Bouenza partageront leur expertise via des stages intensifs, financés par le Fonds national d’appui à l’éducation.
La mobilité étudiante est également encouragée. Dès la rentrée prochaine, cinquante bacheliers de la Cuvette-Ouest bénéficieront d’une « pérégrination académique » de six mois à Madingou pour s’immerger dans les ateliers performants du Sud. Pour les spécialistes, ces circulations pourraient homogénéiser la qualité pédagogique à l’échelle nationale, sous réserve d’un suivi budgétaire strict et d’un accompagnement psychosocial adapté aux élèves déplacés.
Perspectives : consolider l’élan et diversifier les débouchés
Le gouvernement projette de transformer l’essai en alignant l’offre de formation sur les projets structurants du Plan national de développement 2022-2026. Génie civil, fibre optique, maintenance agricole : ces segments devraient bénéficier de nouveaux plateaux techniques cofinancés par la Banque de développement des États d’Afrique centrale. La tutelle réfléchit en parallèle à un label de qualité pour les établissements qui maintiendront un taux d’insertion professionnelle supérieur à 70 % dans les deux ans suivant l’examen.
Au-delà des chiffres, la session 2025 confirme que le baccalauréat technique n’est plus une voie de repli, mais un espace légitime d’ascension sociale, notamment pour les jeunes femmes longtemps cantonnées aux segments généraux ou au secteur informel. La Bouenza illustre le potentiel d’une approche territorialisée, articulée à des politiques publiques cohérentes. Reste le défi de la pérennité : sans investissements continus et sans veille sur l’égalité de genre, l’élan actuel pourrait s’éroder. Les acteurs éducatifs, unanimes, semblent décidés à ne pas laisser cette fenêtre d’opportunité se refermer.