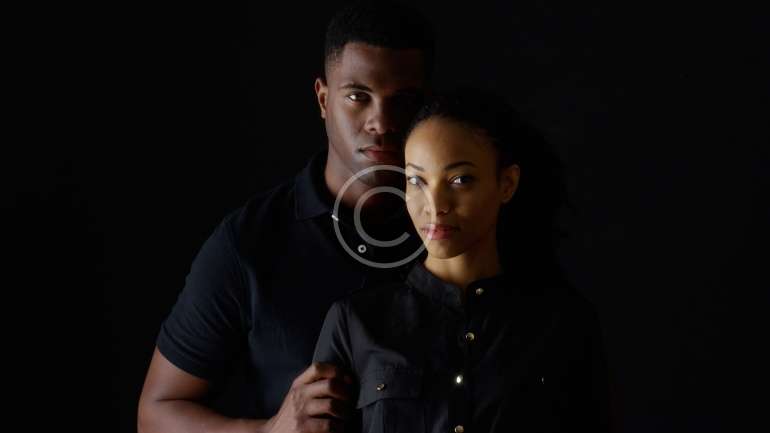Brazzaville au cœur de la diplomatie phytosanitaire
Du 26 au 29 août 2025, Brazzaville devient un laboratoire continental. La capitale accueille l’atelier panafricain de la FAO et de la CIPV sur la sécurité phytosanitaire, rendez-vous technique où se dessinent les futures règles encadrant la circulation des produits agricoles dans toute l’Afrique.
Ces normes, souvent perçues comme abstraites, conditionnent pourtant le quotidien. Elles déterminent si un manioc franchit une frontière sans quarantaine, si un maraîcher peut exporter, et, par ricochet, si une cheffe de ménage disposera demain d’aliments sains et abordables pour sa famille.
Enjeux pour les agricultrices congolaises
Au Congo-Brazzaville, l’agriculture mobilise une main-d’œuvre féminine de plus de 60 %, selon les données du ministère de l’Agriculture. Dans les plateaux batékés ou la Cuvette, les femmes portent l’essentiel du travail de plantation, de récolte et de mise en marché des denrées vivrières.
Or, la perte annuelle de 40 % des cultures évoquée par Pascal Robin Ongoka touche d’abord ces exploitantes familiales. Chaque champ infecté par une mouche des fruits réduit les revenus, limite la scolarisation des filles et accentue la pénibilité domestique liée à l’alimentation.
L’atelier de Brazzaville apparaît donc comme un espace stratégique où les délégués peuvent introduire une perspective genre explicite dans les standards. Sans cela, alertent des sociologues ruraux, le fossé entre textes internationaux et réalité des paysannes subsahariennes risque de se creuser davantage.
Normes internationales et réalité locale
Les projets de normes examinés portent sur la gestion des organismes nuisibles, la certification des semences et l’inspection en poste frontalier. Chaque point implique des coûts de conformité. Le défi consiste à garantir que ces coûts n’excluent pas les petites exploitations dirigées majoritairement par des femmes.
Dans les débats préparatoires, plusieurs États ont rappelé que la facilitation du commerce reste indissociable de la sécurité alimentaire. Le Congo-Brazzaville, par la voix de son ministère, a souligné l’importance d’un dispositif proportionné qui protège les cultures sans freiner les circuits locaux émergents.
Cela rejoint les priorités exprimées par l’Observatoire national congolais des violences faites aux femmes, qui inclut la violence économique dans son champ d’action. Des normes trop rigides pourraient restreindre l’accès des veuves ou femmes chefs de groupement aux marchés urbains, aggravant leur vulnérabilité.
Voix de terrain : attentes des coopératives
Rencontrée à Djambala avant son départ pour l’atelier, Clarisse Oyali, présidente de la coopérative Muninga, insistait : « Nos bananes plantains sont saines. Nous voulons seulement des formations pratiques pour reconnaître les insectes et des tests abordables au poste de contrôle », plaidait-elle.
Dans le Pool, Marceline Mabiala, transformatrice de manioc, redoute surtout les interruptions de transport provoquées par des décisions sanitaires soudaines. « Chaque semaine de blocage signifie une perte de lot, donc moins de liquidités pour payer les aides familiales », explique-t-elle.
Ces témoignages, relayés aux experts, illustrent la dimension genrée de la phytoprotection. La FAO reconnaît désormais que l’adoption d’une norme dépend de la diffusion de connaissances auprès des petits producteurs et, surtout, des productrices qui structurent la distribution de proximité.
Pour donner corps à cet engagement, un module de sensibilisation sur l’égalité de genre figure à l’agenda de Brazzaville. Animé par des formatrices congolaises, il vise à outiller les délégués sur la collecte de données sexuées, condition préalable à toute politique fondée sur des preuves.
Perspectives de gouvernance inclusive
Au niveau institutionnel, le ministère de la Promotion de la femme entend capitaliser cette dynamique. Un protocole d’accord avec l’Agriculture prévoit l’insertion d’indicateurs genre dans le futur plan national phytosanitaire, facilitant ainsi le suivi des effets sur les exploitantes et commerçantes.
Les partenaires techniques soulignent que la diplomatie normative s’accompagne d’investissements. Des laboratoires régionaux, déjà financés en partie par le Programme alimentaire mondial, permettront de raccourcir les délais d’analyse, réduisant le risque de pertes post-récolte qui pèsent lourdement sur les comptes des ménages.
Sur le plan législatif, la Commission économie de l’Assemblée étudie une révision du code phytosanitaire de 2003. L’intégration explicite de la notion d’impact différencié selon le sexe constituerait, pour plusieurs juristes, un précédent régional en matière de droit alimentaire inclusif.
Cap sur 2025 : suivi et mobilisation
À l’issue des quatre jours, les experts rédigeront un avis collectif transmis au secrétariat de la CIPV. Si les propositions congolaises recueillent un large soutien, elles seront soumises à l’adoption lors de la session plénière de Rome au printemps 2026.
D’ici là, les organisations féminines entendent maintenir la pression bienveillante. Des ateliers de restitution seront organisés dans huit départements, afin que chaque groupement de productrices comprenne la portée des normes et puisse formuler des retours avant la phase finale de négociation internationale.
Parce que la sécurité phytosanitaire dépasse le seul cadre agricole, elle devient un enjeu de citoyenneté économique et de justice sociale. Le rendez-vous de Brazzaville rappelle que protéger les végétaux, c’est aussi protéger les droits des femmes qui nourrissent la nation au quotidien.