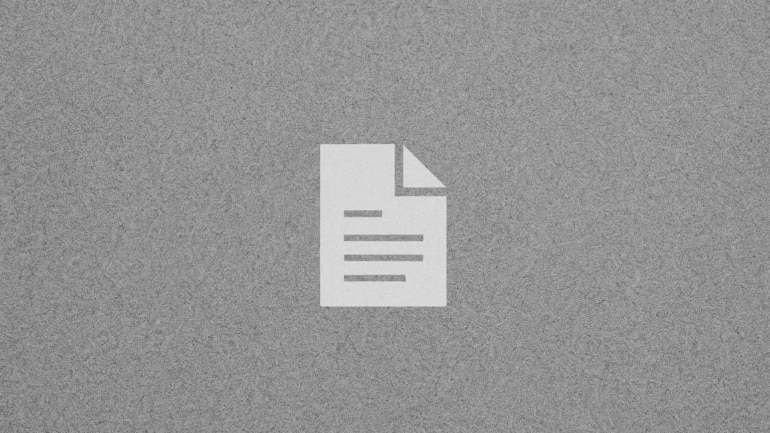Lumière vacillante sur la capitale
Chaque soir, les ruelles de Poto-Poto plongent dans l’ombre, tandis que les générateurs bourdonnent derrière les boutiques. Les coupures répétées, souvent imprévisibles, redessinent le rythme urbain et imposent aux foyers un agenda dicté par les interruptions du réseau électrique national.
Pour de nombreuses Brazzavilloises, la pénombre n’est pas qu’une gêne mais une menace sanitaire et économique. La conservation des aliments, l’accès à l’eau, la continuité scolaire et la sécurité domestique reposent sur une fourniture stable d’électricité, devenue un bien aussi vital que l’air conditionné réclame.
Selon l’Observatoire national congolais des violences faites aux femmes, l’instabilité énergétique accroît la charge de travail domestique des femmes de 28 % en saison sèche, car elles doivent chercher des solutions de substitution, cuisiner plus vite ou compenser l’absence de réfrigération par des achats quotidiens.
Des micro-entreprises fragilisées
Magalie Mambeké, bouchère de quartier à Talangaï, raconte avoir perdu en une nuit quatre glacières de poisson et trois de côtes. « J’ai pleuré en vidant la chambre froide », confie-t-elle, estimant ses pertes à l’équivalent de trois mois de frais de scolarité.
Cette expérience est partagée par des coiffeuses, pâtissières, vendeuses de jus, dont l’activité repose sur un matériel électrifié. Faute de trésorerie, la plupart ne peuvent acquérir de groupe électrogène ; les marges se resserrent et l’indépendance financière chèrement conquise se délite.
À la Chambre de commerce, le service statistique évoque une contraction moyenne de 12 % des revenus des très petites entreprises lors des longues coupures de 2023. Comme l’indique l’économiste Hugues Mayombo, « l’instabilité énergétique frappe d’abord la base productive informelle où les femmes sont majoritaires ».
Causes techniques et climatologiques
Les ingénieurs de la Société nationale d’électricité soulignent que le réseau brazzavillois, conçu pour 200 MW, doit aujourd’hui en véhiculer près de 320 MW aux heures de pointe. Le vieillissement des transformateurs, combiné au raccordement sauvage et au cuivre volé, crée des surtensions fatales.
À ces contraintes structurelles s’ajoute la variabilité hydrologique. Pendant la saison sèche, le niveau du fleuve Congo baisse de plusieurs mètres, réduisant la capacité des centrales hydroélectriques d’Imboulou et de Moukoukoulou. Les délestages deviennent alors un instrument de répartition équitable de l’offre disponible.
Les experts rappellent enfin le coût élevé du fuel destiné aux turbines thermiques d’appoint. « Lorsque le baril dépasse 90 dollars, faire tourner ces unités devient budgétairement sensible », explique une source au ministère de l’Énergie, qui plaide pour un mix davantage centré sur le gaz.
Programmes publics d’amélioration du réseau
Depuis 2021, le Projet d’accès et de renforcement des réseaux électriques, cofinancé par la Banque mondiale, remplace progressivement 360 kilomètres de lignes vétustes et installe des compteurs intelligents. Les autorités communiquent sur une réduction ciblée de 40 % des pannes à l’horizon 2025.
En parallèle, la nouvelle centrale solaire de 55 MW annoncée à Ngoyo devrait injecter ses premiers kilowattheures d’ici fin 2024. « Diversifier la production renforce la souveraineté énergétique », observe l’ingénieure Nadège Ngoma, membre du Réseau des femmes scientifiques, satisfaite que le chantier implique 30 % de techniciennes.
Le ministère de la Promotion de la femme appuie ces projets via un fonds d’appui aux entrepreneuses souhaitant installer des panneaux solaires ou des congélateurs à haut rendement. Plus de 2 000 microcrédits ont déjà été accordés, selon la directrice Géneviève Okila, pour « couper court aux coupures ».
Innovations communautaires et solidaires
Dans les quartiers, des associations de voisinage mutualisent l’achat de petits onduleurs et de lampes LED. À Mfilou, une coopérative féminine gère une glacière communautaire alimentée par un panneau solaire monté sur un conteneur recyclé, permettant de stocker poisson et vaccins infantiles.
Le sociologue Martial Koutou souligne que ces initiatives réduisent la vulnérabilité collective et redonnent du pouvoir d’agir. « Chaque kilowatt autonome change la donne symboliquement : on passe du statut d’usager dépendant à celui d’acteur énergétique », résume-t-il.
Perspectives d’une énergie inclusive
L’accès fiable à l’électricité conditionne l’autonomisation économique des femmes, objectif inscrit dans le Plan national de développement 2022-2026. Les spécialistes recommandent de coupler la modernisation du réseau à des programmes d’éducation énergétique afin que les ménages adoptent des gestes sobres et protègent les équipements.
Pendant que Magalie nettoie ses glacières en attendant la prochaine livraison de courant, l’espérance collective demeure. La lumière n’est ni un luxe ni un slogan, mais un droit social que le Congo s’emploie à universaliser. Le défi est immense, l’élan de résilience l’est aussi.
Le suivi indépendant des coupures, grâce à une application mobile pilotée par de jeunes développeuses, permettra dès 2024 de cartographier en temps réel les délestages. Ces données ouvertes nourriront le dialogue entre usagers, opérateur et décideurs publics, élément clé d’une gouvernance énergétique transparente.
Dans l’attente d’un réseau modernisé, les citoyennes interrogées appellent surtout à la prévisibilité : connaître l’heure des coupures permet d’organiser cuisson, soins et devoirs. Ce simple calendrier, avance l’ONG Énergie pour Tous, serait déjà « une victoire sur l’improvisation ».