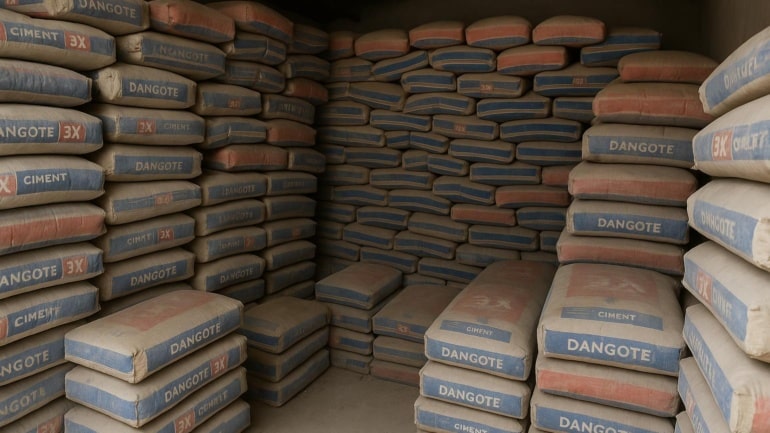Un virage social attendu dans le système éducatif
Avant même la rentrée scolaire, les couloirs bruissent déjà d’une nouveauté institutionnelle : la présence annoncée d’assistantes sociales dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire. La ministre des Affaires sociales, de l’Action humanitaire et de la Solidarité, Marie Cécile Mboukou Kimbatsa, en a fait l’une des priorités exposées durant la dernière quinzaine du gouvernement à Brazzaville. Selon elle, « l’école n’est plus seulement un sanctuaire du savoir, elle devient un maillon de la chaîne de protection sociale ». Dans un pays où plus de sept élèves sur dix fréquentent quotidiennement un espace éducatif public, la décision marque un tournant symbolique et pratique.
Le dispositif, inspiré d’expériences pilotes conduites au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville, vise l’identification précoce des vulnérabilités : décrochage, violences de genre, grossesses précoces, troubles psycho-sociaux et carences familiales. Les assistantes sociales seront invitées à travailler en proximité avec les enseignants, les parents d’élèves et les services de santé scolaire pour orienter les cas les plus sensibles vers les structures compétentes.
Une stratégie nationale inspirée par l’hôpital
Le déploiement à l’école est le prolongement d’un schéma déjà éprouvé dans les hôpitaux publics. Au CHU de Brazzaville, à l’hôpital général de Djiri ou encore à l’hôpital de base de Makélékélé, la présence continue d’assistantes sociales a permis de recenser les patients indigents et de solliciter, le cas échéant, une prise en charge des ordonnances et des interventions chirurgicales par le ministère. « Nous avons constaté qu’aucun diagnostic médical ne peut être complet sans la lecture sociale de la trajectoire du patient », explique la docteure Clarisse Ndzoukou, cheffe de service au CHU.
Transposée à l’école, cette philosophie vise à intercepter des situations de vulnérabilité avant qu’elles ne se chronicisent. Il s’agit non seulement de venir en aide aux enfants en rupture familiale, mais aussi de soutenir les adolescentes exposées à des violences invisibles. Pour la sociologue Madeleine Bouanga, spécialiste des politiques sociales, « le paradigme de l’assistance change : de l’attente passive à l’action préventive ».
L’articulation avec la protection des femmes et des enfants
En République du Congo, les femmes constituent encore l’écrasante majorité des aidants informels et assument une part prépondérante de la charge domestique. La présence d’assistantes sociales formées aux questions de genre permettra d’alléger ce fardeau tout en renforçant la sécurité psychosociale des élèves filles. Les études du Centre de recherche sur la femme et l’enfance montrent qu’une assistance spécialisée peut réduire de 30 % le risque de décrochage scolaire chez les jeunes mères adolescentes.
Les enfants des rues, autre public prioritaire, seront orientés vers le centre d’insertion et de réinsertion où ils reçoivent une formation professionnelle une fois la majorité atteinte. Cet accompagnement individualisé rejoint l’objectif gouvernemental d’autonomisation économique et sociale. « Nous avons le devoir de transformer la vulnérabilité en potentiel », a résumé la ministre, insistant sur le fait que la mesure s’inscrit dans le cadre plus large de l’Agenda 2030 et des objectifs de développement durable.
Le défi des filets sociaux face à la pauvreté
Le projet national « Filets sociaux », successeur du programme Lisungui, se propose de sécuriser durablement les familles démunies recensées dans le registre social unique. L’ambition est claire : passer d’une logique ponctuelle d’assistance à une logique intégrée de réduction de la pauvreté. Les premières évaluations internes révèlent toutefois l’ampleur du défi : plus de 66 000 réfugiés – dont 33 000 originaires de la République centrafricaine – et des milliers de ménages congolais en situation d’extrême pauvreté attendent une couverture effective.
Pour le politiste Richard Tchicaya, « l’arrivée des assistantes sociales dans les écoles devrait accroître la fiabilité des données de terrain ». Les informations collectées seront fusionnées au registre existant, offrant ainsi au gouvernement une boussole statistique pour l’allocation des transferts monétaires conditionnels et des subventions sanitaires. Dans ce schéma, l’école devient un observatoire social de proximité qui alimente, en temps réel, la politique nationale de solidarité.
Regards croisés sur la professionnalisation de l’assistance
Au-delà de l’effectif initial à recruter – que la ministre n’a pas encore précisé – la question de la formation reste centrale. L’Institut national de travail social prévoit d’intégrer un module orienté vers la réalité scolaire et communautaire, tandis que l’UNICEF promet un appui technique en matière de protection de l’enfance. Pour la psychologue scolaire Élisabeth Mokoko, « la compétence émotionnelle sera aussi décisive que la compétence administrative ».
La mesure suscite un consensus prudent au sein de la société civile. Les organisations de défense des droits des femmes saluent la reconnaissance institutionnelle de problématiques longtemps invisibles, tout en réclamant une veille citoyenne pour garantir la pérennité des financements. En filigrane, un espoir grandit : que l’assistante sociale, figure jusqu’ici cantonnée aux hôpitaux, puisse enfin occuper le devant de la classe, non pas pour enseigner, mais pour libérer la parole et réparer le tissu social dès les premiers bancs de l’école.