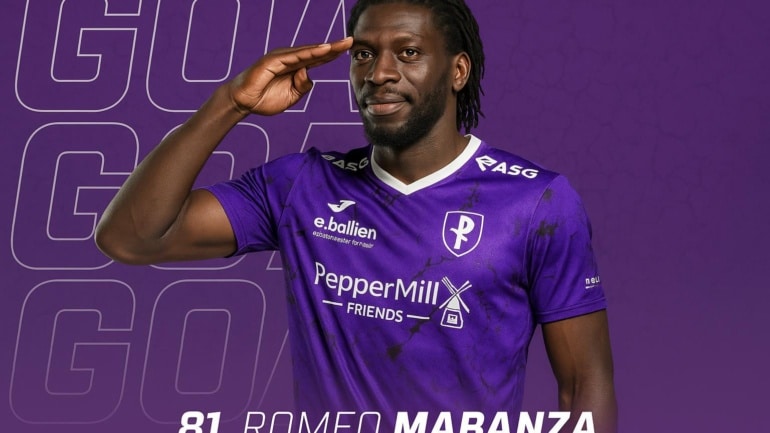Un financement européen décisif
Avec une enveloppe de 220 000 euros, l’Union européenne apporte une respiration financière à la Croix-Rouge congolaise pour endiguer la résurgence du choléra, une maladie hydrique dont l’évolution rapide inquiète les autorités sanitaires du Congo-Brazzaville.
Le premier vice-président Malik Loemba-Makosso a officialisé le lancement du Fonds d’urgence lors d’une cérémonie à Brazzaville, saluant un « partenariat solidaire » entre bailleurs internationaux, gouvernement et volontaires nationaux, tous réunis pour limiter les pertes humaines.
Ce financement couvrira quatre mois d’opérations, jusqu’à fin décembre 2025, période jugée critique pour casser les chaînes de transmission et consolider les capacités d’alerte rapide, selon les responsables de la Fédération internationale de la Croix-Rouge.
Objectifs sanitaires et sociaux de la riposte
La dotation européenne se concentre d’abord sur l’accès à l’eau potable : forages réparés, points chlorés et kits familiaux doivent réduire l’ingestion de germes dans les districts de Mossaka et Loukoléla, identifiés comme foyers actifs.
En parallèle, des unités mobiles de soins soutiendront les structures publiques, fournissant réhydratation orale, antibiotiques ciblés et formation du personnel, afin de maintenir le taux de létalité sous le seuil d’alerte fixé à 1 % par l’Organisation mondiale de la santé.
Les animateurs d’hygiène, bénévoles expérimentés, mèneront des visites de porte à porte pour diffuser des messages simples sur le lavage des mains et la désinfection des surfaces, une stratégie qui, selon le secrétaire général Gabriel Goma Mahinga, « transforme chaque ménage en sentinelle sanitaire ».
Zones à risque et dynamique de la maladie
Depuis juillet, plus de 500 cas ont été enregistrés, dont 35 décès, soit une létalité de 7,1 %. L’épicentre initial de l’Île Mbamou reflue, mais la pression migratoire entre Kinshasa et Brazzaville maintient la menace (Croix-Rouge congolaise, 25 août 2025).
Les autorités sanitaires pointent également la proximité de la province angolaise de Cabinda, où des flambées récentes ont été signalées. Les barges fluviales constituant le principal moyen de transport marchand intensifient les contacts et compliquent le traçage classique des cas.
Dans le département du Congo-Oubangui, la topographie marécageuse ralentit la distribution de chlore et la surveillance épidémiologique. Pour surmonter cet obstacle, des pirogues motorisées, financées par le Fonds d’urgence, transporteront équipements et secouristes vers les villages enclavés.
Concertation nationale et responsabilité partagée
Le directeur de cabinet du ministre de la Santé, le professeur Donatien Mounkassa, a souligné que « le choléra n’est pas endémique au Congo », tout en appelant à une vigilance coordonnée entre services publics, ONG et collectivités locales pour éviter sa pérennisation.
Le chef de service de la prévention des catastrophes, Franck Davy Diangana, estime que la nouvelle dotation constitue « un test grandeur nature pour la plateforme de préparation aux urgences, récemment remise à niveau avec l’appui des partenaires techniques ».
Dans cette démarche, les autorités locales restent décisionnaires : les comités de crise départementaux valident chaque opération logistique, assurant une adéquation avec les plans de développement sanitaire en vigueur et renforçant la redevabilité vis-à-vis des populations bénéficiaires.
La collaboration avec l’Institut national de recherche en sciences de la santé vise à accélérer la confirmation biologique des cas. Des kits de prélèvement supplémentaires sont attendus, condition indispensable pour évaluer l’efficacité des interventions et réajuster les priorités.
Engagement communautaire et perspectives durables
Au-delà de l’urgence, la Croix-Rouge veut inscrire son action dans la durée en renforçant les réseaux de volontaires villageois, véritables relais de la surveillance communautaire. Les formations intègrent désormais des modules sur le changement climatique et la gestion d’eau de pluie.
Selon la sociologue Charlotte Nzila, spécialiste des dynamiques de genre, l’implication des femmes dans ces comités « accroît la diffusion des bonnes pratiques d’hygiène, car ce sont elles qui gèrent majoritairement l’eau domestique ». Ce volet genre constitue un axe stratégique de l’intervention.
Les animateurs culturels envisagent des radios communautaires temporaires pour relayer des émissions en langues locales. L’expérience pilote menée l’an dernier lors des inondations dans la Cuvette avait permis de tripler la fréquentation des points d’eau traités.
À l’issue des quatre mois prévus, un audit conjoint mesurera l’impact du financement européen. La Croix-Rouge espère documenter une baisse d’au moins 70 % des cas, poser les bases d’un système d’alerte pérenne et consolider la confiance des communautés riveraines.
Pour Malik Loemba-Makosso, « chaque succès local nourrit la résilience nationale ». L’enjeu dépasse donc la simple urgence : il s’agit de fortifier une culture de santé publique participative, alignée sur les priorités du Plan national de développement sanitaire 2022-2026.
Les partenaires européens ont, pour leur part, insisté sur l’importance de l’appropriation locale des outils numériques utilisés pour le suivi des stocks de chlore. Une application légère, accessible hors connexion, permettra aux chefs de poste de signaler les ruptures en temps réel.
Ce dispositif, testé pendant l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, a montré qu’une remontée d’information inférieure à 24 heures divise par deux le risque de rechute. Sa généralisation pourrait donc représenter un héritage technologique durable pour le système de santé congolais.
Enfin, la campagne prévoit une évaluation genre-sensible afin de mesurer l’impact spécifique des actions sur les adolescentes rurales.