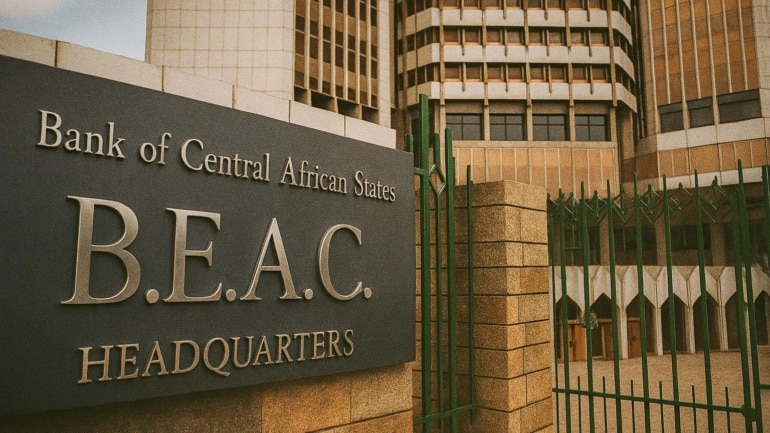Une nouvelle architecture territoriale inclusive
La signature, le 31 mars, du décret présidentiel actant la nomination des préfets dans les quinze départements redessine la gouvernance territoriale congolaise. L’objectif affiché par l’exécutif est de rapprocher l’administration des réalités quotidiennes et d’ouvrir un cycle de gestion plus attentif aux dynamiques locales.
Le ministère de l’Administration du territoire, s’appuyant sur les conclusions du dialogue national de 2024, insiste sur la territorialité départementale comme vecteur d’efficacité. Cette réforme, jugée structurelle par plusieurs universitaires, doit aussi servir de laboratoire aux politiques publiques sensibles au genre.
En donnant des prérogatives élargies aux préfets, le gouvernement attend une meilleure coordination des services déconcentrés, notamment ceux dédiés à la santé maternelle et à la protection sociale. Les priorités dévoilées soulignent la scolarisation des filles, la prévention des violences et l’autonomisation économique à travers le pays.
Visages féminins à la tête des départements
Parmi les quinze préfets, quatre femmes, dont Emma Henriette Berthe Bassinga pour la Cuvette et Micheline Nguessimi pour le Niari, font leur entrée ou confirment leur statut. Cette représentation, encore minoritaire, marque néanmoins un pas significatif comparé à la configuration précédente.
Le décret du 6 mai nommant les secrétaires généraux départementaux renforce cet élan. Des responsables comme Parfaite Eurydice Kodia dans la Bouenza ou Patricia Mireille Babalet au Congo-Oubangui disposent désormais d’une marge d’action accrue pour piloter des dossiers sociaux stratégiques.
Femmes, services publics et proximité
Les analyses de terrain montrent que la présence de cadres féminins facilite souvent la mise en place de programmes sanitaires dédiés à la santé reproductive. À Madingou, des sages-femmes saluent déjà la nomination de Marcel Ganongo, réputé favorable aux cliniques mobiles post-natales.
Dans la Likouala, Jean Pascal Koumba a indiqué vouloir travailler avec les associations de femmes pêcheurs pour améliorer l’accès à la chaîne du froid, condition décisive pour la sécurité alimentaire et la valorisation du travail féminin le long de l’Oubangui.
Cette approche de proximité est encouragée par le ministère de la Promotion de la femme, qui espère un maillage départemental plus réactif face aux alertes de violences domestiques transmises par les cellules d’écoute. La coordination préfectorale pourrait accélérer la prise en charge judiciaire.
Un agenda aligné sur les priorités nationales
Le Plan national de développement 2022-2026 attribue une place centrale à la réduction des inégalités. En alignant leur feuille de route sur ce document, les préfets devront proposer des budgets sensibles au genre, un indicateur désormais scruté par la Commission de planification.
Interrogé, le sociologue Ferdinand Okombi souligne que « l’efficacité d’un budget sensible au genre dépend de la capacité des services techniques à produire des données fiables ». Un défi technique qui nécessite des partenariats renforcés entre directions départementales et instituts de recherche.
L’autre priorité demeure l’extension du réseau de centres d’accueil pour victimes de violences, prévu sur neuf départements avant 2026. Les préfets sont invités à identifier des bâtiments publics peu utilisés, démarche qui limite les coûts tout en optimisant l’offre de protection.
Position de l’Observatoire national
Notre institution salue la démarche de territorialisation qui peut devenir un levier pour la prévention et la prise en charge des violences faites aux femmes. Nous restons toutefois vigilants sur la mise à disposition des ressources et la formation continue des agents de terrain.
Un premier rapport d’évaluation sera publié à la fin du premier trimestre 2026. Il relèvera les avancées, telles que la création d’unités mobiles juridiques, et les obstacles, notamment l’insuffisance d’abris d’urgence dans les zones rurales enclavées.
Nous encourageons également la tenue d’un forum annuel réunissant préfets, organisations féminines et partenaires techniques afin d’harmoniser les indicateurs de suivi. L’efficacité collective dépendra de cette capacité de dialogue structuré.
Mobilisation citoyenne et responsabilité partagée
Au-delà des textes, la réussite de cette nouvelle gouvernance repose sur l’implication des habitantes. Les réseaux communautaires, déjà actifs lors des campagnes de vaccination, pourraient devenir des relais d’alerte indispensables en cas de violences ou de mariage précoce.
La radio communautaire, encore écoutée par plus de 70 % des ménages ruraux, sera un outil de sensibilisation privilégié. Plus d’émissions en langues locales sur les droits des femmes sont annoncées, en partenariat avec les services communication des préfectures.
Enfin, la digitalisation des plaintes testée à Brazzaville devrait être étendue. Ce dispositif, accessible via smartphone, permet aux victimes d’obtenir un numéro de dossier et un rendez-vous sans se déplacer, limitant les risques de représailles familiales.
Perspectives économiques pour l’autonomie féminine
Plusieurs préfets ont inscrit dans leur programme l’appui aux coopératives féminines d’agriculture et d’artisanat. À Dolisie, Micheline Nguessimi envisage la création d’un fonds départemental de microcrédit, alimenté par le partenariat public-privé, pour soutenir les initiatives génératrices de revenus.
Le Programme des Nations unies pour le développement se dit prêt à fournir un accompagnement technique. Selon sa représentante, « la stabilité institutionnelle actuelle offre un cadre propice à l’investissement social », condition essentielle pour que les femmes rurales transforment durablement leurs revenus.